Le livre
Il s'agit ici non pas d'un livre sur le chalet, mais sur son premier propriétaire Antoine Favre. Écrit par Henri Maître, l'un de ses descendants, l'ouvrage évoque la vie romanesque de ce personnage hors du commun. Laurent Nicolet, du journal Le Temps, nous en dit un peu plus.
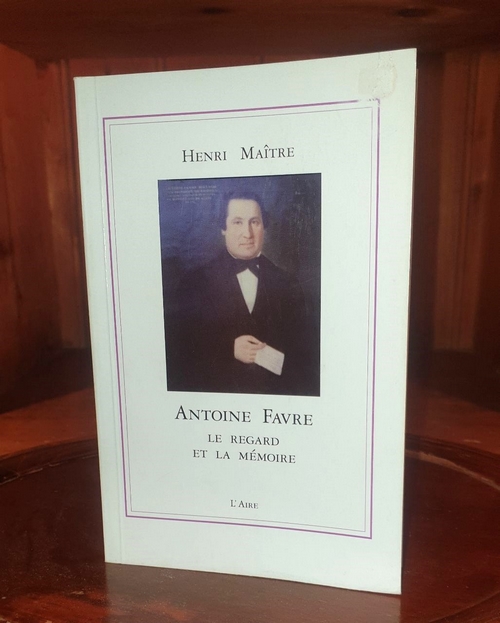
Evolène, 1840 : un notaire au cœur de la guerre civile
La figure d'Antoine Favre, notable au temps où le Valais comptait deux gouvernements, est évoqué par un de ses descendants.
Laurent Nicolet (publié le 21 juillet 2006)
«Des voies de fait succèdent aux insultes. Les gendarmes veulent s'interposer. On les renverse, on les frappe, on leur arrache leurs armes.» Ce 22 mars 1840 à Evolène, le président de la commune, le notaire Antoine Favre, est atteint d'une pierre à la tête. Il s'en remettra, mais l'échauffourée fera deux morts et de nombreux blessés.
Antoine Favre, notable aujourd'hui oublié et dont il ne reste que les 2500 actes notariés et un portrait à l'huile signé Brouchoud, revit brièvement à travers une petite plaquette mélancolique que lui consacre, sur le thème de la mémoire, du temps qui passe et surtout qui efface, son arrière-arrière-petit-fils, l'enseignant et écrivain Henri Maître.
Président donc, mais aussi député au Grand Conseil, juge, capitaine et receveur du district d'Hérens, Antoine Favre fit sa carrière publique en des temps étranges. Le Valais connut alors, en une décennie, deux guerres civiles, l'une entre Hauts et Bas-Valaisans, dont la bataille d'Evolène fut un épisode, puis entre radicaux-libéraux et conservateurs, avec la bataille du Trient, qui redonne en 1844 momentanément le pouvoir à ces derniers. Une décennie qui s'ouvre avec deux Conseils d'Etat autoproclamés, l'un conservateur, installé à Sierre et lié aux dizains hauts-valaisans, l'autre basé à Sion et de tendance libérale.
Les deux empires
La commune d'Evolène est elle-même coupée en deux, avec deux présidents: Antoine Favre, qui a épousé les idées nouvelles et règne sur Evolène même et le hameau de Lannaz, et Joseph Follonier, fidèle au gouvernement de Sierre et dont «l'empire», plus haut, s'étend sur les Haudères et les villages dits «Sur les Rocs». C'est une distribution de sel organisée par le gouvernement sierrois et interdite par Antoine Favre qui déclenche la bagarre du 22 mars.
Après l'épisode du Sonderbund, en 1847, les radicaux-libéraux reprennent la main et règnent en Valais pendant dix ans. Antoine Favre, dans le même laps de temps, est désormais le maître unique d'une commune d'Evolène réunifiée.
La commune d'Evolène est elle-même coupée en deux, avec deux présidents: Antoine Favre, qui a épousé les idées nouvelles et règne sur Evolène même et le hameau de Lannaz, et Joseph Follonier, fidèle au gouvernement de Sierre et dont «l'empire», plus haut, s'étend sur les Haudères et les villages dits «Sur les Rocs». C'est une distribution de sel organisée par le gouvernement sierrois et interdite par Antoine Favre qui déclenche la bagarre du 22 mars.
Après l'épisode du Sonderbund, en 1847, les radicaux-libéraux reprennent la main et règnent en Valais pendant dix ans. Antoine Favre, dans le même laps de temps, est désormais le maître unique d'une commune d'Evolène réunifiée.
Le retour des conservateurs au pouvoir en 1857 le renvoie à sa vie privée. Antoine Favre a épousé une veuve de 14 ans plus âgée et dont il aura trois filles. Puis, devenu veuf à son tour, il épouse la bonne du curé, une Saviésanne cette fois de seize ans sa cadette. La dernière de ses filles, Philomène, émigre en 1894 avec mari, nombreux enfants et maigres bagages, au Canada, pour fonder, dans une enclave francophone du Manitoba, le village de Notre Dame de Lourdes: «Le destin là-bas vengera peut-être le destin d'ici.»
Qui était Antoine Favre, se demande Henri Maître, que pensait-il, et que pensaient ces familles «bétaillères et céréalières»? «Le monde pour eux, quel est-il au-delà du réduit fermé par le verrou glaciaire de Volovron?» Le dernier mot, peut-être, revient au dessinateur Rodolphe Töppfer, qui rencontra Antoine Favre à Evolène et le décrit dans ses carnets de voyage comme unissant «à la dignité de magistrat, les naïvetés du montagnard et l'instinct du tueur de chamois.»
Henri Maître: Antoine Favre, le regard et la mémoire, Editions de l'Aire, 71 pages.
